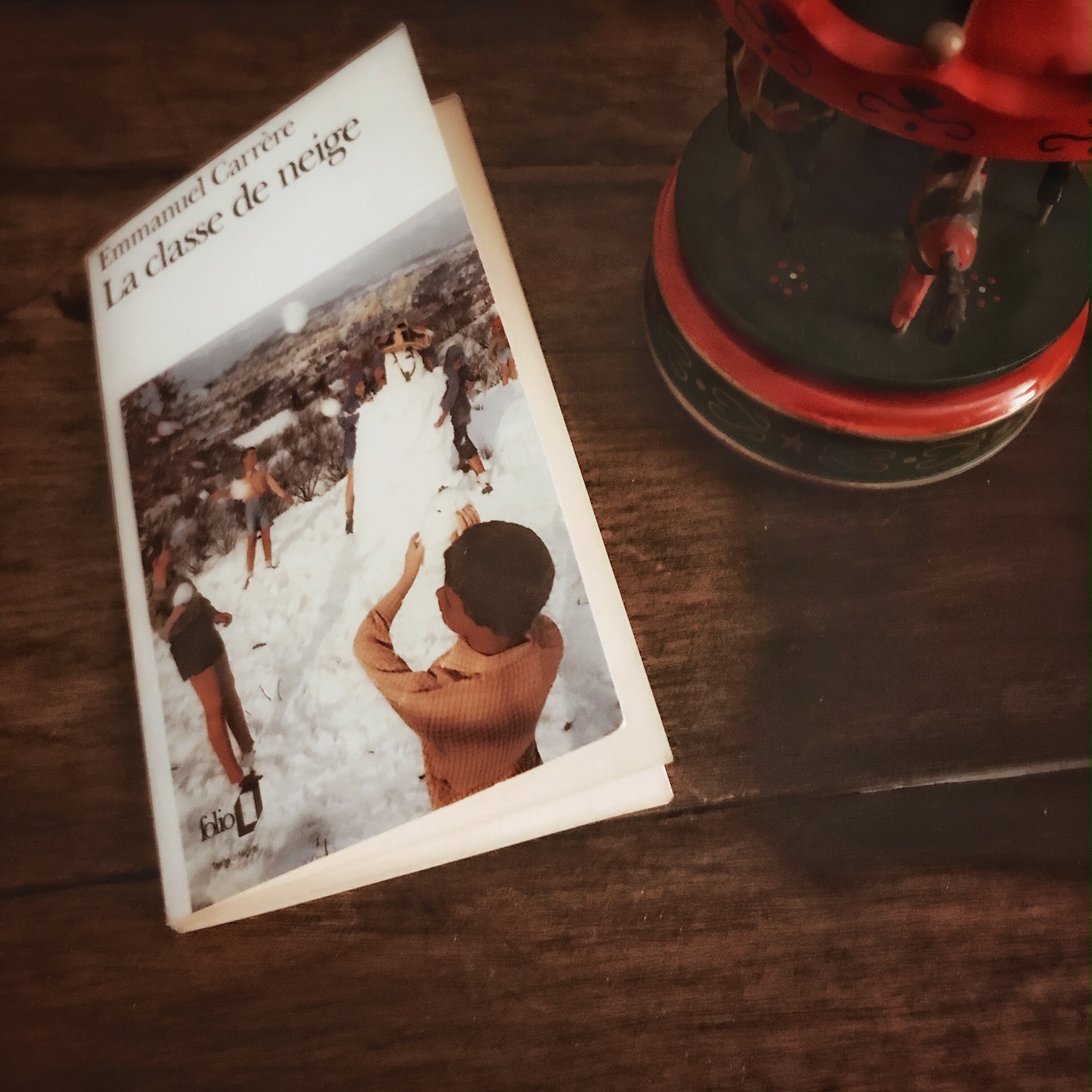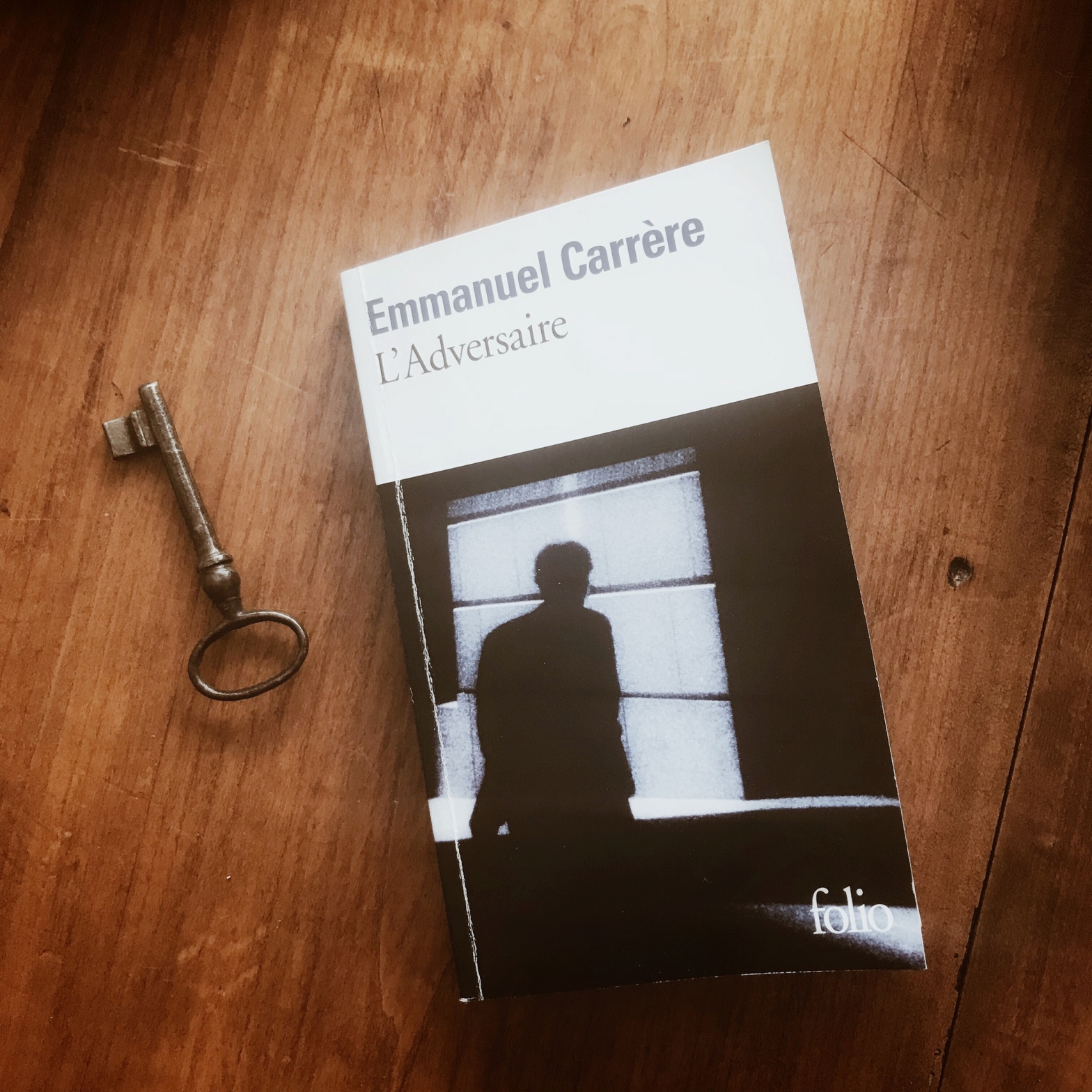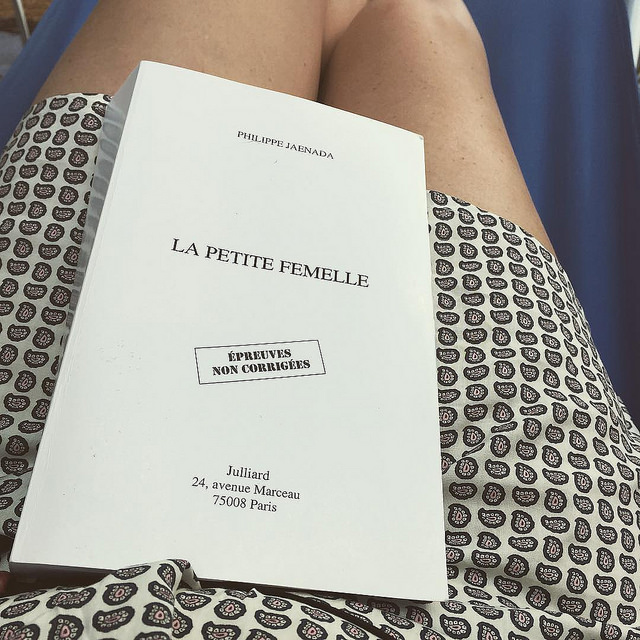La maîtresse reconnut qu’on ne pouvait pas en être certain, hélas. Elle pouvait seulement dire qu’on était très pointilleux sur la sécurité, que le chauffeur conduisait prudemment et que des risques raisonnables faisaient partie de la vie. Pour être absolument certains que leurs enfants ne soient pas écrasés par une voiture, il faudrait que les parents ne les laissent jamais sortir de la maison ; et encore, ils n’y seraient pas à l’abri d’un accident avec un appareil ménager, ou simplement de la maladie. Certains parents admirent la justesse de l’argument, mais beaucoup furent choqués par le fatalisme avec lequel la maîtresse l’exposait. Elle souriait même en disant cela.
Je suis allée une fois en classe de neige, quelque part en Auvergne ou par là-bas. Je n’en garde pas un très bon souvenir : d’abord il n’y avait pas de neige, et le seul jour où il n’y en a eu, je me suis blessée au genou. Je ne suis jamais remontée sur des skis depuis, et je crois bien que de toute façon je ne serais guère douée pour cette activité, qui demande un certain sens de l’équilibre, et l’équilibre, c’est chez moi comme ce qu’on appelle la raison : sous-développé. Cela étant dit, j’avais très envie de découvrir enfin Emmanuel Carrère dans le registre de la fiction, notamment avec ce roman sur lequel j’étais tombée par hasard (enfin, façon de parler) l’autre jour.
Nicolas est un enfant à part, isolé et moqué par les autres autant qu’il est surprotégé par ses parents. Ce séjour en classe de neige, en collectivité, s’annonce donc, dès le départ, comme une épreuve pour lui, épreuve qui se transforme en cauchemar.
Un roman prodigieusement angoissant, parfaitement mené, dans lequel on reconnaît parfaitement la manière de Carrère, ses obsessions et notamment celle pour le tragique du fait divers, et qu’il est passionnant de lire à la lumière de ses œuvres ultérieures, car tout y est déjà en germe. De fait, L’Adversaire plane déjà sur ce roman qui en constitue presque une première pierre.
Mais c’est aussi un extraordinaire roman initiatique de la transformation et du passage à l’âge adulte. Ecrit à hauteur d’enfant, puisque le point de vue adopté est celui de Nicolas même s’il est écrit à la troisième personne, il fonctionne comme un conte. Cruel, mais un conte. De fait j’ai, encore une fois, beaucoup réfléchi à ce roman à travers le prisme de Femmes qui courent avec les loups. Je sais, cela devient une manie, mais je ne crois pas me tromper même si Carrère ne pouvait pas l’avoir lu, mais comme je l’ai déjà dit, la force des génies est de comprendre intuitivement des choses qui n’ont pas encore été clairement formulées. Nicolas est un garçon mais cela ne change rien au propos : c’est un enfant étouffé, empêché, sur la psyché duquel plane un grave danger : barbe-bleue, ogre dévorant, qui l’empêche d’être lui-même ; il connaît l’origine de ce danger mais ne peut le formuler clairement, et ses nuits sont peuplées de cauchemars. On retrouve, ici, de nombreux éléments du conte, les motifs de la neige, de la forêt, mais aussi des références directes, notamment à La Petite sirène, conte préféré de Nicolas qui repense à cette nuit où elle se transforme, et perd sa jolie queue de poisson et sa voix mélodieuse pour avoir des jambes, là où ce qui était encore elle combattait ce qui serait bientôt elle. Conte du passage à l’âge adulte : devenir adulte, c’est perdre quelque chose dans la douleur, pour trouver autre chose. Et ce que Nicolas perd, c’est toute son innocence…
Bref, un roman exceptionnel, assez court mais d’une richesse incroyable ! Je ne me lasse décidément pas de découvrir les œuvres de Carrère que je n’ai pas encore lues !
La Classe de neige
Emmanuel CARRÈRE
POL, 1995 (Folio, 1996)