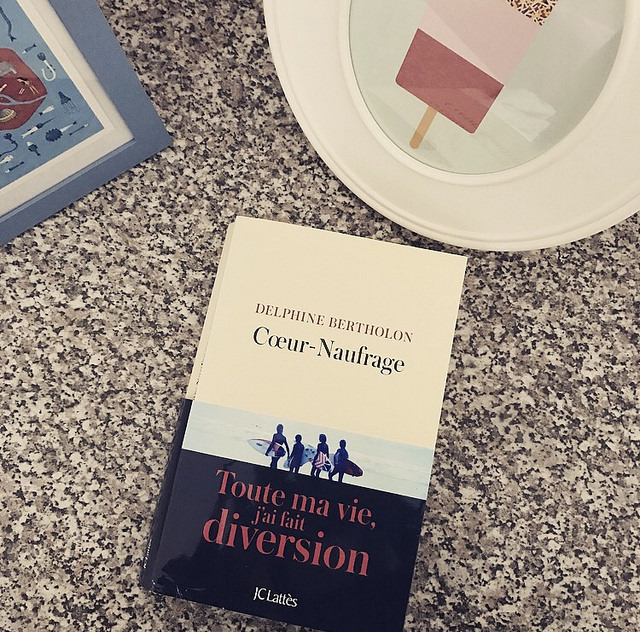En tout cas un déclic vient de se faire en toi. Parce qu’Alice a prononcé le mot magique — partager ? Il n’est même pas certain qu’il ait franchi ses lèvres, mais même si tout est romancé, ils ont raison tes deux bienveillants amis ligués contre toi : tu es investi malgré toi d’une sorte de mission. Ce n’est pas le témoignage d’Erwan Larher qui est important, c’est ce que le seul écrivain présent ce soir-là au Bataclan en ferait s’il s’attaquait au sujet, au matériau.
Il serait facile de commencer en disant que c’est le livre que je ne voulais pas lire. Facile, mais pourtant vrai : jusque-là, j’ai soigneusement évité tous les ouvrages publiés sur le 13 novembre. Parce que je ne peux pas. Et puis voilà, il y a celui-là.
Erwan Larher, je ne le connaissais pas, ni comme écrivain (jamais lu, mais apparemment je loupais quelque chose — mais on ne peut pas tout lire) ni comme personne. Mais il se trouve que nous avons beaucoup d’amis en commun. Amis virtuels, amis réels, des personnes à qui je tiens et qui tiennent à lui.
Ces personnes, le soir du 13 novembre, alors qu’il était au Bataclan, puis que nul après l’assaut ne savait quel était son sort, ces personnes s’inquiétaient pour leur ami du Bataclan. Par contamination, capillarité, empathie, je ne sais pas, je me suis inquiétée aussi, cette nuit où je n’ai pas dormi.
Peut-être aussi parce que j’avais besoin de donner un visage à ces victimes, et qu’un homme qui était aussi précieux pour tant de gens ne pouvait être qu’une belle personne, que j’avais aussi envie de connaître.
C’est donc comme ça que j’ai lu ce livre que je ne voulais pas lire et que son auteur ne voulait pas écrire, mais que la nécessité lui a imposé.
Tout commence par l’histoire d’un garçon qui aime le rock — plus : le rock est inscrit dans son ADN. Et, comme il aime beaucoup Evil of Death Metal, il achète un ticket pour leur concert du Bataclan, le 13 novembre 2015…
C’est un texte dont on ne ressort pas indemne, on ne va pas se mentir : j’ai versé des litres de larmes, j’ai été bouleversée, et je vais avoir un mal fou à mettre des mots sur les choses, parce qu’il s’agit, vraiment, d’une expérience de lecture très intime, qui remue beaucoup de choses. Cathartique.
Mais, voyeurs, passez votre chemin : il n’y a ici nul sensationnalisme, nul exhibitionnisme, tout au contraire est en pudeur et en mise à distance du pathos. Peu de « je » — l’auteur se dédouble, s’adresse à lui-même, se met à distance et raconte l’essentiel à la deuxième personne. « Tu » met à distance le pathos, même dans les moments poignants — et il y en a, bien sûr, malgré une certaine forme d’autodérision qui ne semble jamais quitter l’auteur.
Le pendant, devenir caillou, l’après, la reconstruction. Le déclic, qui fait qu’il se sent obligé, par une force supérieure, d’écrire sur ça, parce qu’il était le seul écrivain à vraiment pouvoir le faire, parce qu’il est le seul à l’avoir vécu, et que peut-être il l’a vécu parce qu’il devait l’écrire. Le destin.
Alors le livre se fait, sous nos yeux — mais en inventant autre chose : pas un témoignage, pas un récit, pas vraiment un roman non plus. Quelque chose, un objet littéraire, qui travaille la langue de l’intérieur, la dynamite parfois. Un livre qui s’invente par le fait même de s’écrire. Qui prend en compte toute la complexité du monde en intégrant les « vu de l’extérieur », textes que lui ont donné ses amis pour partager ce qu’ils ont vécu, ce soir là. Qui transfigure le réel et fait de ce moment un petit morceau de destin.
A la pulsion de mort, celle des démons terroristes dans l’âme desquels le livre fait parfois un détour, succède la pulsion de vie. L’amitié, valeur cardinale, le sexe, l’amour qui surgit et donne du sens à tout. Douloureux, ce texte est aussi, finalement, lumineux, et absolument nécessaire ! Un coup de coeur — ou plutôt un uppercut !
Le Livre que je ne voulais pas écrire
Erwan LARHER
Quidam, 2017
Je partage donc je suis :