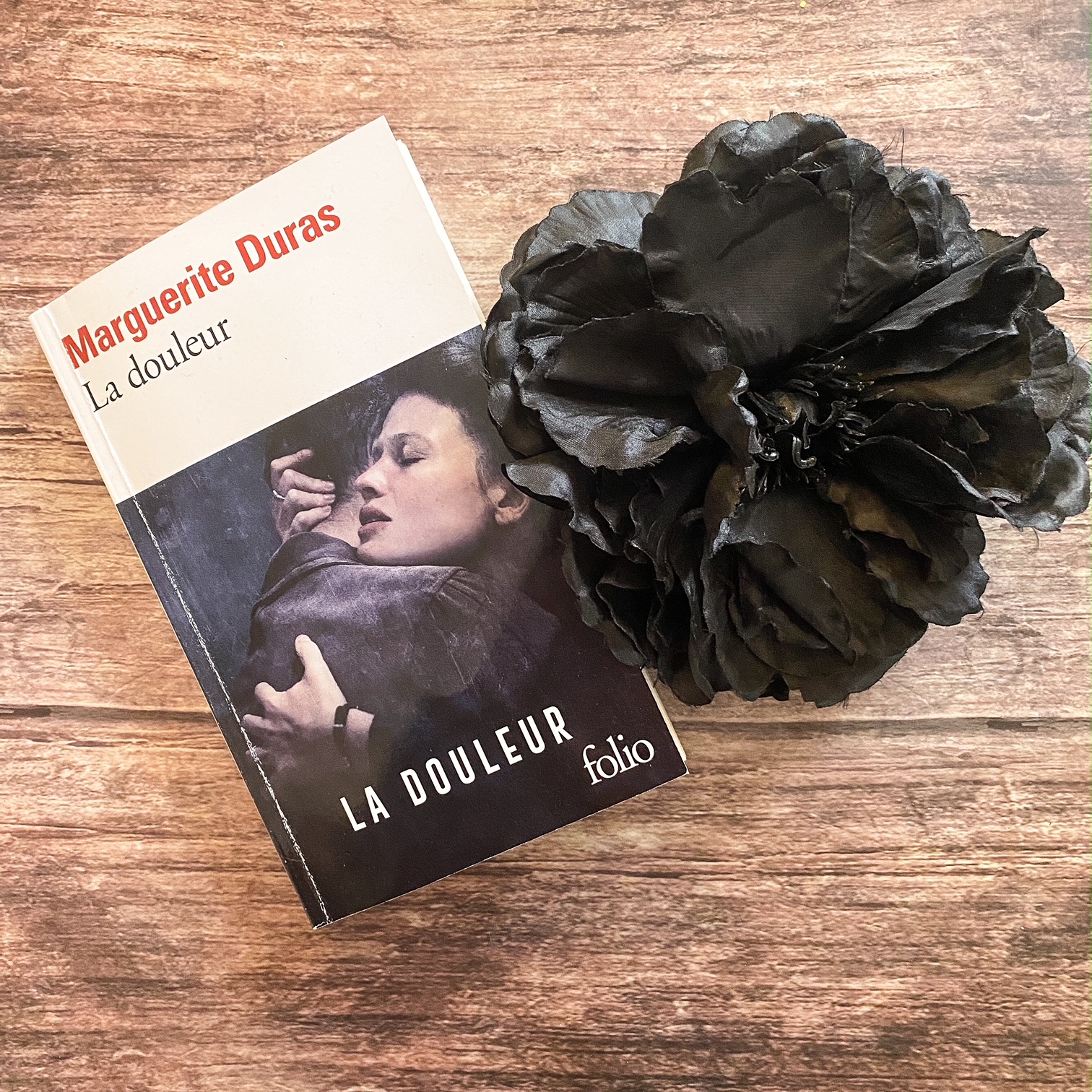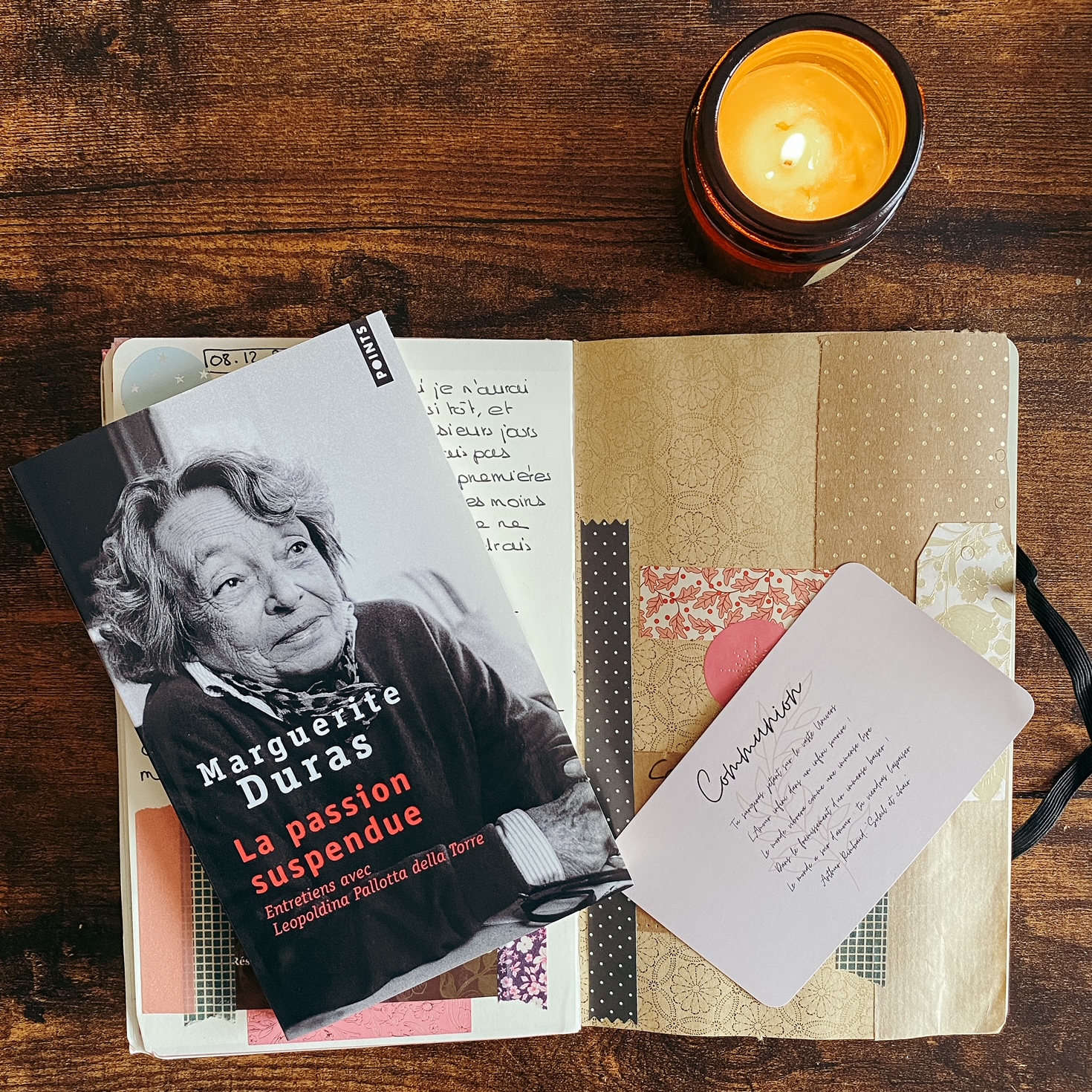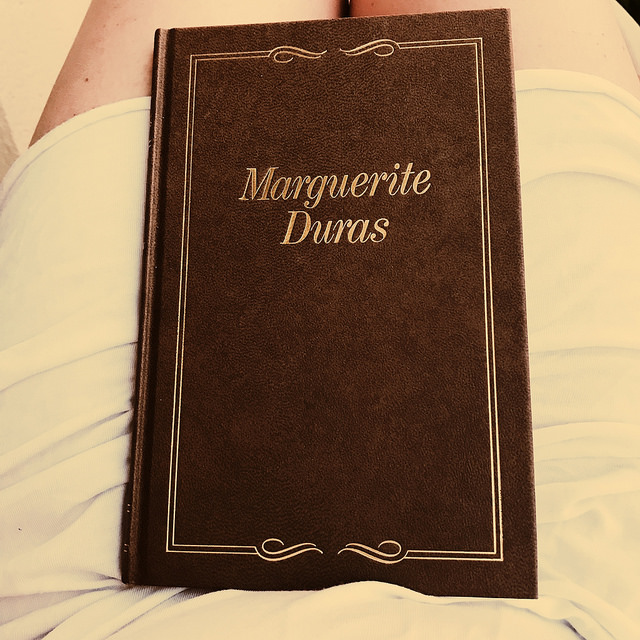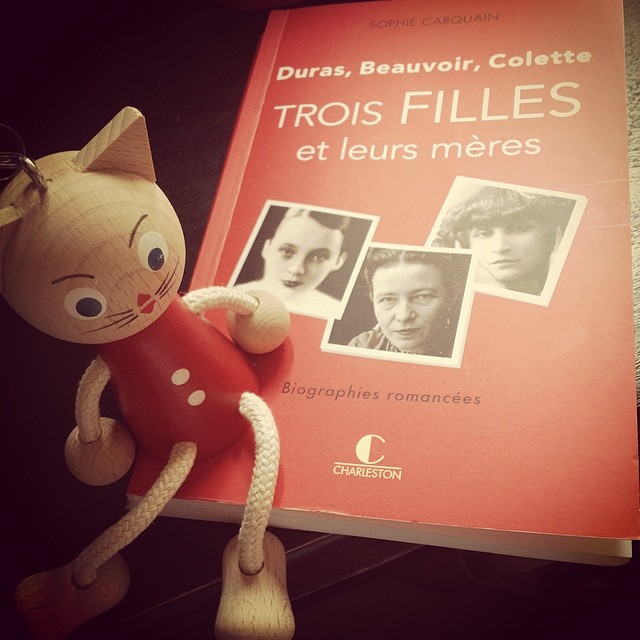Il pourrait revenir directement, il sonnerait à la porte d’entrée : « Qui est là. – C’est moi. » Il pourrait également téléphoner dès son arrivée dans un centre de transit : « Je suis revenu, je suis à l’hôtel Lutetia pour les formalités. » Il n’y aurait pas de signes avant-coureurs. Il téléphonerait. Il arriverait. Ce sont des choses qui sont possibles. Il en revient tout de même. Il n’est pas un cas particulier. Il n’y a pas de raison particulière pour qu’il ne revienne pas. Il n’y a pas de raison pour qu’il revienne. Il est possible qu’il revienne. Il sonnerait : « Qui est là. -C’est moi. »
Je ne sais pas pourquoi, j’ai eu à nouveau envie de lire Duras. Mais comme j’ai un peu de mal avec certains de ses romans, je me suis plongée dans ce récit plus ou moins autobiographique. En réalité, plusieurs récits.
Le premier récit, qui donne son titre à l’ensemble, La Douleur, est un journal de l’attente, que Duras dit avoir retrouvé dans une armoire, qu’elle ne se souvient pas avoir écrit et qu’elle pense impossible d’avoir écrit au moment des faits, et qui existe pourtant. C’est la lente torture de l’attente de son mari, après la libération des camps, dans l’incertitude de ce retour.
Les autres récits forment un ensemble un peu hétéroclite : les trois premiers sont liés thématiquement et abordent la Libération et l’épuration. Dans le premier, écrit 40 ans après les faits, elle raconte la relation trouble qui l’a liée un temps à l’homme qui a arrêté son mari, et qu’elle espionne pour la Résistance ; deux autres racontent, mais cette fois à la troisième personne, deux arrestations et interrogatoires de collaborateurs. Quant aux deux derniers textes, « c’est de la littératures », dit-elle, et je n’ai honnêtement pas compris ce qu’ils faisaient là, ni de quoi il était question, en fait.
Le fait est que c’est le premier texte qui m’a bouleversée, d’autant qu’il résonnait particulièrement fort avec les événements actuels et que ce n’était pas fait exprès, je l’avais commencé avant. Mais c’est vraiment un texte magnifique, très intime et en même temps universel, et c’est ce qui fait sa force. Il y a la douleur, et il y a, tout de même, cette lumière dont Duras ne parle pas explicitement mais qui est là tout de même : que pour un écrivain, tout devient texte, et que si l’écriture ne sauve de rien, elle aide tout de même, un peu, à ne pas sombrer, même dans les pires moments.
La Douleur
Marguerite DURAS
POL, 1985 (Folio, 1993/2021)