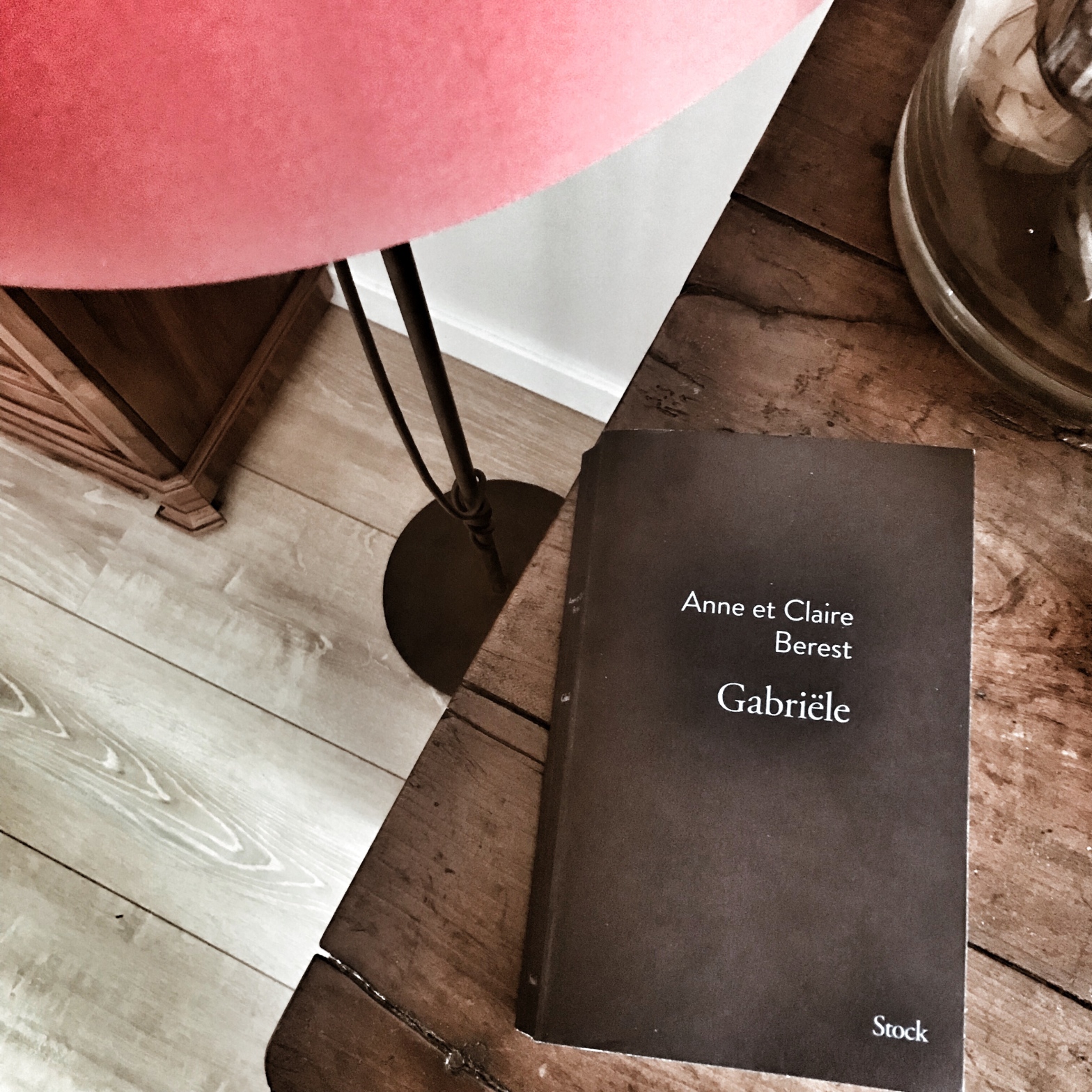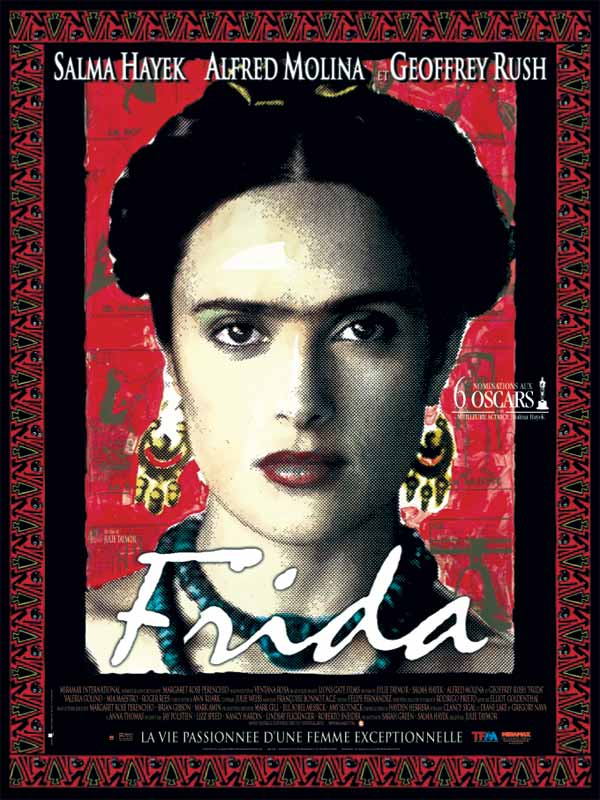Elle se rappelle qu’il y a longtemps, très longtemps, elle aimait marcher ainsi, au hasard dans Paris. Elle avait alors toujours une bouteille d’eau sur elle. Mais cette Hannah qui portait le même nom qu’elle aujourd’hui, était-ce la même personne ? Etait-ce bien elle ? Elle a beau chercher, elle n’en retrouve pas la trace. Les souvenirs, oui, bien sûr, les souvenirs, elle les possède quelque part, dans sa tête. D’ailleurs, si elle fait un effort pour se remémorer le passé, elle retrouve des images, des moments. Mais les traces intérieures, les morsures intérieures, la pulsation intérieure — la joie intérieure de cette Hannah d’alors —, où sont-elles aujourd’hui ? Dans quel trou noir ont-elles sombré ? Rien n’en aurait donc été conservé ? La vie pourrait anéantir celle qu’on était, l’anéantir totalement ?
Je n’ai lu aucun roman de Laurence Tardieu (ne me demandez pas pourquoi, il n’y a pas de raison particulière, à part l’habituelle « on ne peut décidément pas tout lire »). Par contre, j’avais beaucoup aimé (forcément) L’écriture et la vie. Alors, aucune hésitation pour découvrir ce roman…
Un matin d’avril, sur le trottoir d’en face, Hannah croit voir Lorette, sa fille, disparue sans laisser de traces sept ans auparavant. Le temps, alors, se fissure. Mais la vie d’Hannah n’est pas la seule à basculer ce jour-là : Simon, son frère, Lydie, sa meilleure amie, et Paul, le mari de cette dernière, vont aussi voir s’écrouler toutes leurs certitudes…
Un magnifique roman sur le temps et les souvenirs, ces moments de basculement qui nous poussent à chercher du sens et partir en quête de soi.
Si plusieurs personnages gravitent autour d’elle, c’est bien Hannah le point focal de l’histoire, et on peut dire qu’elle est un magnifique personnage, absolument fascinant : une femme artiste, pour qui la peinture est le seul moyen d’être au monde, de s’y ancrer, elle dont l’histoire est hantée par l’Histoire, celle de l’Europe de l’Est et ses blessures dont il est difficile de parler ; sa fille, au début, est une entrave, une rivale à sa passion, et pourtant, lorsqu’elle disparaît Hannah cesse de peindre.
Elle n’est plus vivante, et toute la force de ce roman est de montrer comment laisser à nouveau passer la lumière.
Un roman plein de vie et d’émotions, d’une grande sensibilité, qui m’a beaucoup touchée et profondément émue : il est habité d’une forme de grâce qui nous montre le chemin et parle directement à l’âme…
Nous aurons été vivants (lien affilié)
Laurence TARDIEU
Stock, 2019