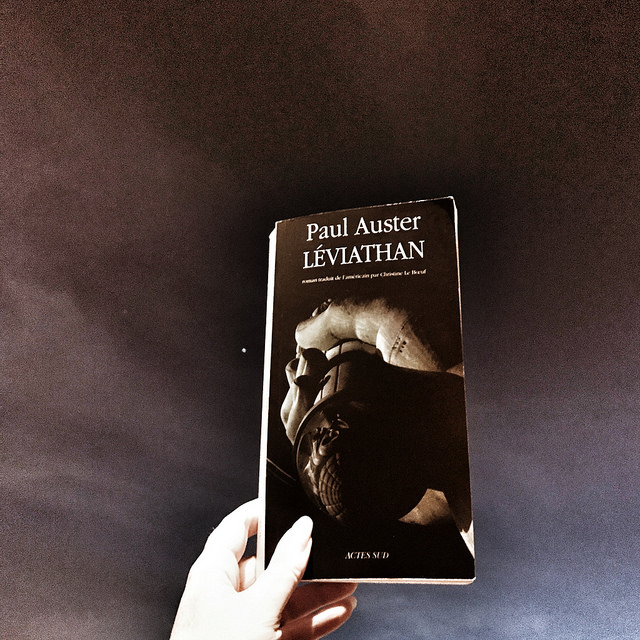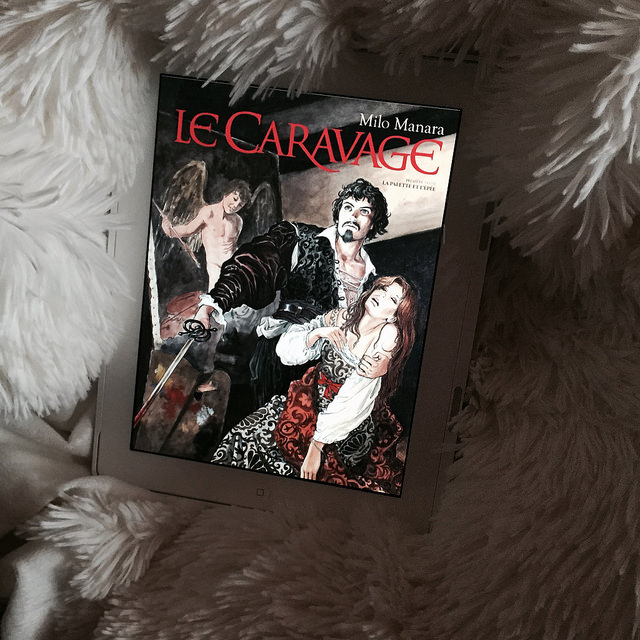Sachs aimait ces ironies, les vastes folies et les contradictions de l’histoire, la façon dont les faits ne cessaient de se retourner sur eux-mêmes. A force de se gorger de tels faits, il arrivait à lire le monde comme une œuvre d’imagination, à transformer des événements connus en symboles littéraires, tropes quelque sombre et complexe dessein enfoui dans le réel.
Oui, je sais, j’avais déjà lu mon Paul Auster annuel. Mais nonobstant le fait que je l’avais lu un peu tôt alors que d’habitude je l’emmène avec moi en voyage, il se trouve que j’avais été un peu frustrée par Le voyage d’Anna Blume, non pas par ses qualités, c’est un très grand roman, mais parce que ce que j’aime chez Paul Auster, c’est qu’il me parle d’écriture et d’écrivains, et qu’en l’occurrence ce n’était pas le cas.
Or cela faisait très longtemps que je voulais lire Léviathan, depuis que j’avais vu le travail coopératif de Sophie Calle et de Paul Auster suite à ce roman à Beaubourg, travail qui m’avait fascinée. Voilà comment Paul Auster s’est retrouvé à Lisbonne…
Peter Aaron est écrivain. Lorsqu’un jour, par hasard, il lit un entrefilet dans le journal racontant qu’on a retrouvé le corps non identifié d’un homme tué en manipulant des explosifs, il sait, malgré l’absence totale d’indices, qu’il s’agit de son ami Benjamin Sachs. Il décide alors, dans l’urgence, avant que la police ne progresse dans l’enquête, d’écrire un livre où il raconte ce qu’il sait de son ami…
Du très, très grand Paul Auster. Comme il le fait souvent et notamment dans Le livre des illusions, il s’amuse avec la référentialité, brouillant les pistes de l’identité.
Paul Aaron a en effet bien des points communs avec Paul Auster, et pas seulement ses initiales : toute sa ligne biographique est calquée sur celle de l’auteur, les dates, certains événements, sa femme Iris (anagramme de Siri). Pourtant, évidemment, ce qui nous est raconté ici est de la pure invention, mais par ce procédé devient vraisemblable, et permet de réfléchir aux liens entre la vie et l’art, au monde réel comme s’il était un roman dans lequel chercher des signes.
Et de fait, cela fonctionne au-delà des espérances de l’auteur : foisonnant de personnages d’artistes, le roman met notamment en scène Maria, dont certaines des œuvres qu’il lui attribue sont inspirés de travaux de Sophie Calle qui elle-même, en retour, a réalisé des travaux de Maria qui avaient été imaginées par Auster.
Et finalement, tout est comme ça dans le roman : jeux de miroirs et d’illusions, mise en abyme, vertige identificatoire… Cela donne un formidable roman sur la création, mais aussi sur l’Amérique, dont il interroge les valeurs et les symboles, sur l’engagement politique et le terrorisme !
Du très grand Paul Auster donc (oui, j’aime insister), ce roman prend sa place aux côtés de ceux que j’ai préférés de l’auteur (je les ai tous aimés, mais il y en a qui me nourrissent plus que d’autres et celui-là en fait partie) !
Léviathan (lien affilié)
Paul AUSTER
Traduit de l’américain par Christine Le Boeuf
Actes Sud, 1993