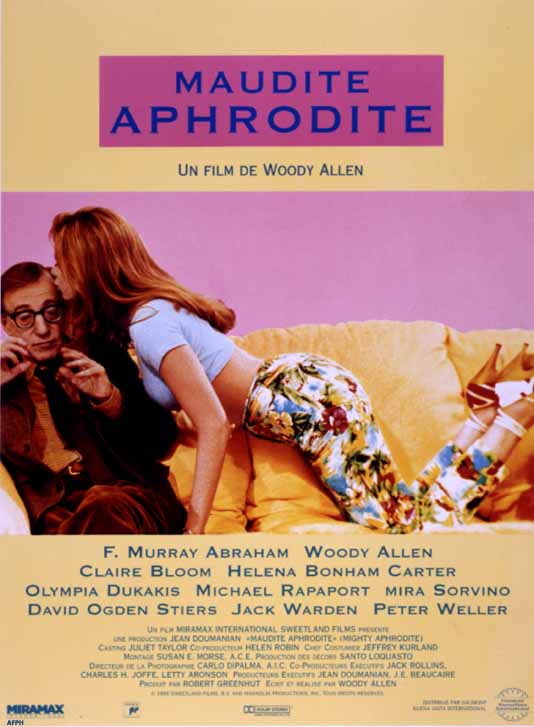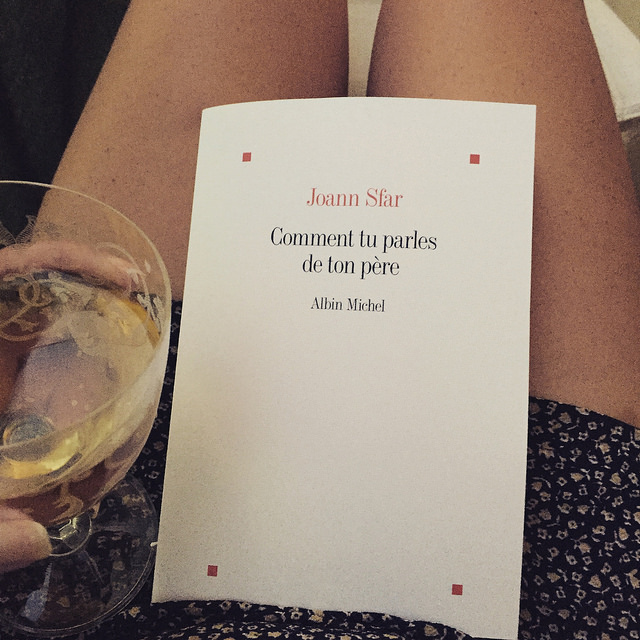Je me ressaisis. Pas question de redevenir une âme errante corvéable à merci, comme aux premiers temps de mon trépas. Aucune envie de fragiliser cette autonomie relative qui m’a coûté tant d’efforts. La présence obligée qu’entraîne l’exhumation de mon corps ne sera, je suppose, qu’une parenthèse sans suite. Mon rappel sur Terre s’achèvera quand mon caveau sera refermé. Je ne fais plus partie de l’avenir de Fabienne : je dois accepter de ne rien pouvoir pour elle, quelle que soit la force de ses prières.
Chaque année c’est le même rituel, aux alentours du mois de mai : le dernier roman de mon auteur chouchou, que je lis d’une traite, en une soirée délicieuse. Chaque année la curiosité de découvrir ce qu’il a été inventer, mais toujours avec la même confiance, la certitude de passer un bon moment (j’en ai aimé certains moins que d’autres, mais il n’y en a aucun que je n’ai pas aimé du tout).
Ce roman est une suite de La vie interdite, mais on peut tout à fait le lire de manière indépendante car les événements sont clairement rappelés.
Mort depuis 25 ans, Jacques Lormeau (enfin, son corps) est exhumé pour une recherche en paternité, et son esprit se voit donc ramené auprès des siens, alors qu’il était bien tranquille, et se retrouve à naviguer d’un personnage à l’autre, sa femme, sa maîtresse, son fils, la jeune fille qui espère qu’il est son père, et quelques autres personnages.
Il y a tout de même, chez l’auteur, une obsession pour cette thématique de la filiation et de la paternité, mais traitée à sa manière. C’est profondément drôle, léger malgré le tragique, grâce au regard surplombant de ce fantôme qui va et vient de l’un à l’autre. Et surtout, c’est réconfortant, comme un doudou : plein d‘amour et de tendresse, et on sait que quoi qu’il arrive, cela va bien se finir (même si je suis un peu réservée sur un point, niveau honnêteté des personnages mais passons), et par les temps qui courent c’est plutôt bienvenu ! Et toujours, ce tour de magie qui consiste à allier la gaité, et la mélancolie !
La Vie absolue
Didier van CAUWELAERT
Albin Michel, 2023